[Dimanche 11 septembre 2022] Les ennemis de la gauche en général, et de la gauche unie en particulier, doivent bien se frotter les mains en attisant la polémique née cette fin de semaine des déclarations de Fabien Roussel à la Fête de l’Humanité sur « la gauche du travail » et « la gauche des allocs ». Opposer le travail aux allocs, c’est offrir sur un plateau à l’extrême droite et à la droite les fruits de leur patient travail de sape auprès des couches populaires de la population. Un travail sournois et destructeur qui consiste à attiser la haine et la détestation des pauvres entre eux, à monter les travailleurs précaires contre les chômeurs, à chauffer les chômeurs et les travailleurs précaires contre les immigrés, à inventer une classe méprisable entre toutes: celle des profiteurs (une classe, remarquez-le bien, qu’on ne va jamais traquer chez les bourgeois que l’on excuse toujours d’essayer par tous les moyens, légaux et illégaux, d’échapper à l’impôt…).
Ce réflexe consistant à opposer aides sociales et salaire des travailleurs est à ranger dans le registre des petites dégueulasseries régulièrement faites aux couches les plus faibles de la population pour les maintenir dans un état de culpabilité permanent, et détourner leurs colères de ceux qui devraient en être la cible: les exploiteurs qui les sous-payent quand ils ne les privent pas tout simplement de travail en supprimant des emplois pour mieux s’enrichir. La grande réussite du Rassemblement national, partout où il s’est fait élire, c’est d’avoir convaincu les travailleurs pauvres et les prolétaires à peine mieux nantis que ceux qu’ils devaient vraiment détester, bien avant les capitaines d’industrie, bien avant les évadés fiscaux, bien avant tous les premiers de cordée, c’est d’abord ceux qui touchent de l’argent sans travailler, ces chômeurs qu’ils seront peut-être eux-mêmes un jour, et surtout ces étrangers qui sont si faciles à repérer dans la rue. Cette détestation est d’autant plus facile à nourrir que détesteurs et détestés sont souvent frères est soeurs de malheur, vivent dans les mêmes quartiers et se croisent tous les jours, aux sorties des écoles, aux caisses des magasins hard discount, quand ce n’est pas dans la queue des Restos du coeur. On est dans la haine de proximité, le circuit court, c’est dans l’air du temps… Pendant ce temps-là, la machine tourne à plein régime et la distribution des revenus continue de se déplacer inexorablement des salaires vers le capital en aggravant dramatiquement les inégalités.
Car enfin, réfléchissons deux minutes: de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on prononce les mots « allocations » ou « aide sociale »? De quelque chose dont a des raisons d’être fiers, ou de quelque chose dont il faut avoir honte? Pour certains, qui ne sont pas rares sur les réseaux sociaux, toucher des aides sociales, c’est « vivre aux crochets de la communauté », une aide sociale perçue dans la durée est assimilée à une « rente de situation ». Un type au RSA est « un rentier », il « jouit » d’une rente!
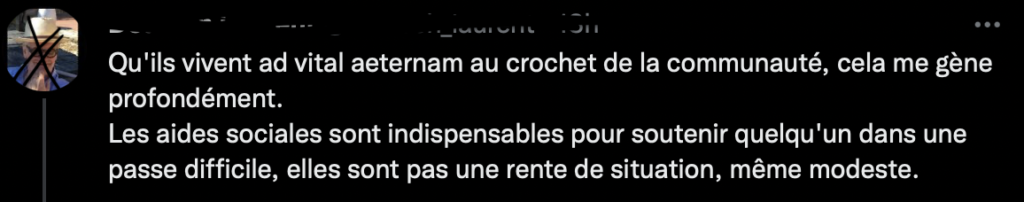
On voit comment le choix d’un certain vocabulaire arrive à faire apparaître « l’aide sociale » comme une sorte de coffre fort rempli de richesses dans lequel les fainéants et les profiteurs sont invités à puiser pour mener une vie de rentiers aux crochets de la communauté. Mais ceux qui parlent comme ça ont-ils seulement vécu avec 800 euros par mois pendant plus d’une année? A-t-on vu des hordes de profiteurs se jeter, par choix délibéré, sur les aides sociales pour « jouir » d’une vie sans travail? Quand on lit les commentaires qui tombent en avalanches nauséabondes sur les réseaux sociaux, on est frappé de trouver toute une foule de bien informés qui connaissent, ici ou là, parfois même dans leurs propres familles, des gugusses qui auraient volontairement choisi de se contenter d’une vie aux minima sociaux. Sauf que dans la presse un peu sérieuse, personne n’a jamais lu le témoignage direct d’un de ces rentiers bas de gamme qui viendrait raconter sa vie de rêve au RSA, ni celui d’une mère de famille nombreuse qui viendrait expliquer combien elle adore bousiller sa santé en accouchant une fois par an pour percevoir des allocations familiales. Comment se fait-il qu’une pratique de l’abus prétendument aussi répandue ne soit pas mieux documentée? Pourquoi ne trouve-t-on pas en librairie de « Guide des bons plans pour vivre une vraie vie de pauvre »? J’entends d’ici les ricanements entendus, les accusations de naïveté, le déferlement de contre exemples brandis par toute une armée de « connaisseurs » de la chose sociale et de la nature humaine. Sauf que les faits sont têtus.
La vérité bien sûr, c’est qu’une vie aux minima sociaux n’est pas un sort enviable, et que ce n’est jamais par choix que l’on se réfugie sous le parapluie de l’aide sociale. La vérité, c’est que nous devons être fiers d’avoir contribué à construire un modèle social qui permet aux plus modestes de ne pas tomber dans les tréfonds les plus hideux de la misère noire lorsqu’ils sont privés de travail, qu’ils sont frappés par la maladie ou victimes d’accidents. Non seulement nous devons en être fiers, mais nous devons aussi protéger ceux qui perçoivent ces aides d’être exposés aux affres de la honte et de l’humiliation. Il y a quelque chose de misérable — parce que cela relève de la volonté d’humilier — dans cette manie de désigner à la vindicte ceux qui perçoivent des aides sociales. On trouvera toujours, ici ou là, quelques olibrius qui se contentent des minima sociaux et s’en trouvent fort bien, mais combien sont-ils? Est-ce bien honnête de laisser planer l’idée qu’ils seraient partout? Et quand bien même on en trouverait cent, ou mille, cela justifierait-il qu’on remette en cause un modèle social que nos parents et grands-parents ont construit au prix de tant de luttes? Plutôt que d’en faire un outil de division au bénéfice de l’ordre ultra-libéral, on ferait mieux de réfléchir aux moyens de le consolider, de rendre plus efficace et performant, plus accessible aussi, tant il est avéré que nombre de ceux qui pourraient y prétendre n’en font pas toujours la demande.
Ce dont nous devrions avoir honte en revanche, c’est d’avoir laissé se créer des situations dans lesquelles nos concitoyens les plus pauvres sont placés devant le choix entre deux misères: celle de percevoir des aides sociales, ou celle de travailler pour un salaire qui ne permet pas de vivre décemment. C’est pour cela que le combat pour la revalorisation des salaires est essentiel. Dans le monde qui est le nôtre, les bas salaires sont le corollaire des hauts revenus. Une entreprise qui paye peu s’assure de gagner plus. Il y a une injustice insupportable à voir sans cesse augmenter les profits pendant que le pouvoir d’achat des plus modestes ne cesse de se réduire. Et ce n’est certainement pas de la faute des pauvres si la perspective d’un travail harassant, précaire, et très mal payé n’est guère plus désirable que la perspective de devoir se contenter des minima sociaux.
Ce n’est pas en s’attaquant aux aides sociales que l’on résoudra cette situation, mais en augmentant les salaires. Et cette augmentation des salaires ne peut s’opérer que d’une seule manière: par la réduction des profits que certains réalisent d’une manière qui, il faut bien le dire, devient scandaleuse. Scandaleuse pourquoi? Parce qu’elle se fait, justement, sur le dos de ceux qui travaillent dur et qui vivent mal, au mépris des principes républicains dont certains qui feraient mieux de se taire se gargarisent volontiers à tout bout de champ dans l’espace public. Il est urgent de repenser le partage des richesses, de réinterroger la notion de propriété, de sonder le principe d’égalité. Pour cela, il faut s’extraire des polémiques, sortir du registre de l’invective généralisée. Tomber dans le piège du populisme en cherchant à cliver la partie la plus faible et la plus fragile de notre corps social est donc une faute grave qui fait le lit de l’extrême-droite rampante, et des ultra-libéraux qui dirigent le monde. Ces questions ne doivent pas fracturer la gauche, mais la souder.


