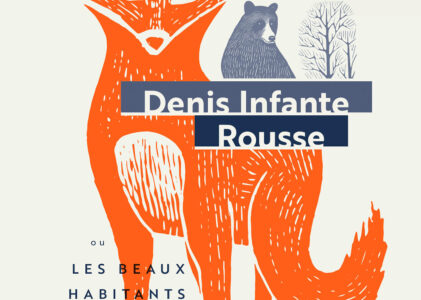Le meilleur moyen de reprendre l’écriture d’un blog temporairement abandonné, c’est encore d’emprunter le chemin de la lecture. Commençons donc par le tout premier livre de 2024, à paraître le 4 janvier prochain aux éditions Tristram. « Rousse, ou les beaux habitants de l’univers » est un court et fulgurant roman de Denis Infante, un livre parfait pour se remettre quelques idées en place dans une période d’immense confusion mentale aussi bien que morale. Rousse n’est pas « un livre de politique », mais un livre assurément politique en ce qu’il nous invite à penser le monde sans nous et, ce faisant, à repenser la mécanique des rapports sociaux, non pas comme une spécificité humaine donc supranaturelle, mais comme une composante pleine et entière de la Nature elle-même.
Nous sommes dans un monde postapocalyptique, dans lequel subsistent encore, entre de grands espaces voués aux sécheresses et à la désolation, des formes de luxuriance mystérieusement préservées. Les humains, on le comprend assez vite, ne font plus partie du paysage. On apprendra, plus tard, vers la toute fin de l’histoire, qu’il y eut un jour des créatures terriblement destructrices et féroces qui dominèrent le monde et finirent par disparaître, balayées par le chaos qu’elles avaient elles-mêmes généré. Ces « faces plates » ainsi qu’on les nomme désormais d’après leurs squelettes dont on trouve, parfois, des monceaux mystérieusement rassemblés aux abords des terres mortes, sont une espèce disparue, dont il n’existe plus aucune représentation. Les vivants qui peuplent désormais la Terre n’ont aucun moyen de se figurer ce à quoi pouvaient bien ressembler ces êtres dont on ignore s’ils étaient à plumes, à écailles ou à poils, ni encore moins à quoi pouvaient bien servir ces choses sur lesquelles ils tombent parfois et dont le lecteur — mais lui seul — finit par comprendre qu’il s’agit des restes d’une route, d’un pont effondré, d’une carlingue d’avion. Tous ces artefacts — plus personne n’en a la moindre idée — servaient à raccourcir les distances, contribuaient à rapetisser la planète en donnant aux humains la dangereuse et mortelle illusion d’être bien plus grands qu’ils n’étaient en réalité. Nous sommes revenus désormais dans un temps où le Monde est de nouveau « immense, incommensurable », au point que « nul vivant sur terre ou dans vaste ciel ne peut en parcourir étendue entière en une vie, aussi longue soit-elle[1] ».
Dans ce monde d’une primale âpreté, Rousse, une jeune renarde à l’esprit libre décide de se mettre en quête de cieux plus cléments. Au cours de son voyage initiatique, elle va braver mille dangers et rencontrer des vivants qui deviendront ses maîtres en art de vivre. L’ourse Brune, le corbeau Noirciel, l’éléphante Ecorce de Hêtre, etc.
On ne peut parler de ce livre sans s’attarder sur cette langue si particulière utilisée par Denis Infante. L’enchaînement des mots, l’apparente frugalité du langage rendue par la suppression des articles définis et indéfinis, la musique que fait entendre ce phrasé subtilement heurté, tout cela nous fait basculer dans un monde à la fois familier et autre, un monde qui pourrait tout aussi bien être d’après que d’avant. La suppression des articles rend les mots, et le monde qu’ils décrivent, indéterminés. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une « langue inventée », mais plutôt d’une « langue retrouvée » qui s’apparenterait à un parler médiéval. Ici ou là, l’auteur recourt avec parcimonie à l’emploi de néologismes qui portent en eux la trace de notre langue devenue langue morte. Il y a dans ces « krakodiles » et ces « olifants » que l’on croise comme une trace fantomatique de l’humanité disparue. Les humains — c’est étrange — subsistent dans la langue, à l’insu de ceux qui la parlent.
Ce qui distingue la langue médiévale de la nôtre, ce qui la singularise, c’est son rapport consubstantiel au mystère. Notre langue à nous, celle de maintenant depuis au moins trois siècles, est une langue du savoir et de la science, c’est une langue qui dit et qui nomme, une langue en surplomb, qui n’hésite pas à afficher son ambition performative, une langue affirmative qui aspire au vrai. La langue médiévale est une langue qui s’accommode du non-savoir et du mystère, une langue de la quête et de l’évocation, la langue d’un monde encore indéfini, que l’on tente de décrire et circonscrire par périphrases et analogies. Au fil de ses conversations avec le vieux corbeau sage Noirciel, Rousse comprend que «mots disent, mots racontent, mots expliquent » mais aussi — et le choix du verbe est formidable — que « mots inventent univers »[2].
Ce qui est sublime dans ce monde terriblement menaçant et hostile, c’est la mécanique des solidarités qui se nouent entre les êtres, — la renarde, l’ourse, le corbeau, l’écureuil ou l’éléphant — qui ont à première vue si peu en commun, et au deuxième regard, tout à partager. Les liens s’organisent dans un monde qui ne se comprend pas, qu’on ne s’explique pas, mais dans lequel il n’y a rien d’autre à faire que de tenter d’y vivre. Et pour y parvenir, il n’y a pas meilleure manière que de s’y mettre à plusieurs : là est l’intelligence de Rousse, de Brune, de Noirciel et des autres qui s’engagent dans cette utopie concrète consistant, par une tentative de reliance, à vouloir rassembler ce qui est épars.
Cette fable qui a de redoutables accents de fiction réaliste est un livre hautement politique en ce qu’il nous invite à contempler le résultat de ce qu’il semble désormais acquis que nous avons entrepris et engagé avec entrain et détermination, à savoir la destruction pure et simple de l’Humanité. Que reste-t-il après les Humains ? Il reste, et c’est une sacrée bonne nouvelle, la vie formidable et fantastique. « Terre tourne et tourne et tourne toujours, comme ombre tourne chaque jour. C’est formidable et captivant mystère pour Maîtresses, Maîtres et toutes créatures pensantes », peut-on lire à la presque toute fin de l’histoire. Ce à quoi nous invite ce petit livre magique, c’est à renouer sans peur avec le mystère, à accepter ce fait que la somme de nos ignorances sera toujours vertigineusement plus importante que celle de nos connaissances. C’est un peu, d’une certaine manière, ce à quoi nous invitait aussi le regretté Bruno Latour en nous rappelant que l’Humain est un élément consubstantiel de l’espace Gaïa, cette fine couche aérienne et souterraine qui enveloppe la Terre, et dans laquelle s’est déployé ce que nous nommons « la vie ». Vouloir à toute force s’extraire de cette condition, c’est bêtement et simplement vouloir s’extraire de la vie. On peut lire ce texte, l’histoire de Rousse, comme une sorte de manuel d’atterrissage.
Pour commencer 2024 et redescendre sur Terre, lisez « Rousse ». Elle est renarde et elle n’a pas peur. Nous sommes humains, et il est grand temps d’avoir peur.

[1] « Rousse, ou les beaux habitants de l’univers », page 75
[2] Ib. Page 97