
Si l’on voulait parler du caractère des femmes, du courage, de la force ou de l’endurance des femmes, on pourrait, dans la liste des personnes dignes d’être citées en exemple, s’arrêter sur le nom d’Elisabeth Dupuy-Mitterrand, figure de la gauche gersoise décédée en plein avril des suites d’un cancer. La maladie longtemps contenue a fini par avoir le dernier mot sans avoir néanmoins jamais réussi à la détourner de ses devoirs de maire de Sion, son cher village aux confins du Gers et des Landes. Avec sa disparition, c’est la grande page de l’histoire du Mitterrandisme dans le département qui se referme doucement.
Apprenant la triste nouvelle, le souvenir me revient d’un déjeuner à trois, il y a déjà vingt ans, alors que j’avais sollicité sa mère, Lydie Dupuy, pour une rencontre de courtoisie. « Venez, nous déjeunerons, m’avait-elle dit. Il y aura ma fille… » Journaliste, je venais d’être nommé dans le Gers où l’on me confiait la direction de la rédaction départementale du journal qui m’employait. Je faisais, à droite et à gauche, « le tour des popotes », le meilleur moyen de s’imprégner de l’histoire des lieux, de comprendre rapidement qui est qui. J’allais donc à la rencontre des gens, prenais le temps de les connaître, les laissais me raconter ce qui leur paraissait important que je sache des histoires locales, de leurs vies personnelles et de leurs parcours professionnels, de ce qu’ils pensaient de telle ou tel et, le cas échéant, de ce qu’il conviendrait que j’en pense à mon tour. Un exercice plaisant pour qui, en faux dilettante, a passé sa vie à se demander pourquoi les gens — lui compris — faisaient ce qu’ils faisaient plutôt qu’autre chose… Sous diverses formes musardières, j’ai pratiqué l’exercice avec pas mal de monde, écoutant les mots et les silences (ne jamais oublier d’écouter les silences), observant les menus gestes, guettant les signaux faibles, m’attardant où les affinités voulaient bien prendre, fuyant comme la peste les mauvais joueurs et les fâcheux. Dans un petit département comme le Gers, le tour fut rapidement fait.
Au croisement de ces rencontres informelles, de ces papotages teintés de civilités, le recoupement des fausses confidences (parfois lâchées avec un excès de confiance devant l’inconnu qui fait le benêt), mais aussi la manière dont on vous reçoit, dont on vous évite ou, plus rarement, dont on vous fout dehors, sont extrêmement riches d’enseignements. Ce que l’on vous dit comme ce que l’on ne vous dit pas, ce que l’un minimise et que d’autres maximisent, ce que les uns vous dissimulent et que les autres vous révèlent, tout cela vous permet assez rapidement de cartographier le réseau des liens d’amitié ou de détestation, de savoir où vous mettez les mains et les pieds en même temps que vous tissez votre propre toile de relations d’estime et de confiance.
Sous diverses formes musardières, j’ai pratiqué l’exercice avec pas mal de monde, écoutant les mots et les silences (ne jamais oublier d’écouter les silences), observant les menus gestes, guettant les signaux faibles, m’attardant où les affinités voulaient bien prendre…
Sur les conseils d’un confrère depuis longtemps en poste dans le département, j’avais donc pris contact avec Lydie Dupuy, une femme qui avait compté et comptait encore, veuve de l’ancien maire de Nogaro (le docteur Jean Dupuy), ancienne députée, et mère d’Elisabeth, ex-belle-fille de feu le Président de la République François Mitterrand. Jean Dupuy, dit-on, avait fait la connaissance de François Mitterrand au début des années soixante sur un parcours de golf. Le courant était passé. Son statut de résistant ayant combattu dans le bataillon de l’Armagnac n’y était sans doute pas pour rien. Une amitié s’installa entre les deux hommes, puis entre les deux familles. François Mitterrand suggéra à Jean Dupuy de se présenter à l’élection municipale de Nogaro, ce qu’il fit. Il fut élu maire en 1965 et présida aux destinées de la ville jusqu’en 1989.
Ainsi Elisabeth, fille de Jean, rencontra Jean-Christophe, fils de François. Le mariage fut célébré en 1975, le 12 avril, à Château-Chinon, sous-préfecture de la Nièvre et capitale du Morvan dont François Mitterrand était le maire depuis plus de quinze ans déjà (1959). Sur les photos, il porte autour de la taille l’écharpe tricolore en ceinture et arbore un large sourire. Elisabeth a couvert ses épaules d’une capeline. Elle a bouclé ses longs cheveux blond platine au BaByliss® (à moins que quelque coiffeur ne l’ait fait pour elle à l’aide des instruments appropriés). Dans Le Monde de 2004, la journaliste Ariane Chemin lui prête « un joli minois à la Miou-Miou ». Jean-Christophe est filiforme, élégant, les cheveux mi-longs, une touche d’évanescence dans le regard comme il sied à la jeunesse de l’époque. Ses joues sont rasées mais il porte barbe au menton et courte moustache, ainsi qu’une chemise ouverte dans l’échancrure de laquelle il a noué un foulard. Son père est cravaté. Nous sommes bien dans les seventies.
A ce père et maire qui lui tend par-dessus la table le livret de famille dûment rempli et tamponné, il lance un regard étonné, presque enfantin, comme s’il était surpris de se trouver là, pour une fois centre de l’attention sous le feu des regards et de tous ces sourires radieux. A l’époque, il est depuis deux ans journaliste à l’Agence France Presse et court déjà l’Afrique. Lorsque François sera élu Président de la République, il sera contraint de lâcher son métier et se retrouvera recasé en « Monsieur Afrique » à l’Elysée. Un saut dans l’inconnu de la diplomatie, sans doute une très haute marche à gravir, le début d’une saga qui, pour lui, finira mal. Ce dont on se gardera bien de l’accabler ici, tant il ne devait pas être simple, pour lui non plus, d’être le fils de ce père-là, François Mitterrand, homme d’Etat, homme de lettres, alliage subtil et capiteux d’ambivalences et de paradoxes dont il fallait bien s’accommoder comme on pouvait, comme on savait.
Entre le mariage et l’Elysée, il y eut la vie journalistique pour lui, politique pour elle qui militait à la section du Parti socialiste de Montparnasse. Suivront l’élection présidentielle, tonitruante explosion nationale de joie et d’émotions puis, en 1984, la naissance de l’enfant à qui l’on donna le troisième prénom du grand-père, Adrien, et enfin le retour à Sion, dans le Gers, pour une vie à l’abri de l’agitation médiatique et des fracas de la haute politique. Il n’y aura guère qu’une entorse, parfaitement maîtrisée, à la discrétion familiale : chaque année le 19 août, dans un de ces rituels qu’il affectionnait tant, François Mitterrand, le grimpeur de Solutré, se rendait à Sion pour célébrer l’anniversaire de son petit-fils. La presse, tenue à distance négociée, publiait annuellement l’image de l’hélicoptère présidentiel se posant sur l’herbe puis, dans une mise en scène quasiment immuable, celle du grand-père président marchant seul avec l’enfant, sa main sur l’épaule, lui murmurant à l’oreille des mots qui n’appartenaient qu’à eux. Quelques confidences distillées aux journalistes locaux à qui l’on faisait, ce jour-là, la part belle, permettaient d’apprendre que le petit avait reçu une maquette de bateau pour ses huit ans, ou que le grand-père entouré de ses petits-enfants avait été vu dans le potager, croquant des tomates cueillies sur pied.
On percevait, chez elles deux, qui se revendiquaient totalement et sincèrement de gauche, les traces d’une éthique bourgeoise quant à la manière de savoir tenir son rang…
Lydie et Elisabeth, donc, m’avaient reçu un jour de grand soleil dans la maison familiale de Nogaro pour un déjeuner-bavardage qui prit son temps. Il fut question de tout et de rien, d’histoire locale, de sagas familiales, de socialisme, d’humanisme, de féminisme, de journalisme, d’actualité judiciaire un peu, et de mitterrandisme sûrement aussi. Lydie raconta beaucoup ses souvenirs de députée, parla longuement de ses engagements pour la cause des droits de l’homme1. Suppléante du député et maire de Saint-Clar André Cellard, elle hérita de son siège lorsque celui-ci fit son entrée dans le gouvernement Mauroy avec la fonction de Secrétaire d’Etat à l’agriculture 2. Je n’ai à vrai dire pas gardé le souvenir précis de tous les propos que nous avons échangés ce jour-là, mais je me souviens très exactement de l’impression que m’ont fait ces deux femmes, la mère et la fille, assurément forgées du même métal, le même plissement d’yeux quand elles vous radiographient du regard, habitées d’une même force, d’une détermination qu’on ne dirait pas bornée ni têtue, mais plus simplement résolue, et peut-être même opiniâtre. On percevait, chez elles deux, qui se revendiquaient totalement et sincèrement de gauche, les traces d’une éthique bourgeoise quant à la manière de savoir tenir son rang, de rester à sa place, de faire honneur au nom et de protéger sa famille, l’expression d’une force en même temps que les traces de probables blessures suffisamment bien contenues pour qu’elles ne se soient jamais transformées en rancœurs vénéneuses. Je le remarquerai plus tard, mais lorsqu’il était question, aux dates anniversaires du fameux 10 mai, d’évoquer devant la presse la grande partie mitterrandienne de leur histoire familiale, elles répondaient souvent à deux: la fille avec sa mère, la mère, avec sa fille. Sans doute cette façon de faire bloc témoignait-elle des ébranlements divers que n’avait sans doute pas manqué de provoquer, au fil des ans, l’entrée de la famille Mitterrand dans la famille Dupuy…
Une anecdote amusante donne une idée assez précise de ce caractère trempé qu’elles avaient en commun, du genre qui vous donne le précieux et agaçant talent de ne jamais rien lâcher face à vos contradicteurs. Lydie Dupuy ne l’a pas su, mais la dernière conversation téléphonique que nous avons eue, peu de temps avant sa mort, m’a envoyée aux urgences de l’hôpital d’Auch pendant plus de 7 heures. Elle m’avait appelé pour obtenir de moi que je publie dans le journal un texte qu’elle avait écrit, une tribune qui concernait un sujet de politique internationale du moment. Je refusais avec tout le tact dont j’étais capable, arguant que le texte en question n’avait aucune espèce de relation avec l’actualité locale dont je remplissais mes pages, et que je ne disposais par ailleurs d’aucun espace dédié à la libre expression des lecteurs, fussent-ils d’éminentes et respectables personnalités. Elle insista. Je persistai à mon tour. Elle fit de même. La conversation resta polie de bout en bout bien que devenant progressivement animée. Elle ne lâchait pas l’affaire. Je m’entêtais. La tension montait en moi, mais je voulais absolument la contenir, ne surtout pas hausser le ton, ne pas me fâcher. La conversation dura vingt bonnes minutes. Un bras de fer impitoyable bien que feutré. Une argumentation implacable. Une épreuve physique extrême pour arriver à garder jusqu’au bout l’équanimité d’un majordome anglais. Lorsque je raccrochais enfin, une violente douleur me barra la poitrine et m’obligea à m’asseoir. Un médecin fut appelé au téléphone. Il insista pour que quelqu’un m’accompagne directement aux urgences. Après plusieurs heures d’analyses et observations diverses, l’urgentiste finit par me dire que l’on ne trouvait rien, tout en ajoutant, pour tempérer mon soulagement: « Ce n’est pas parce qu’on ne trouve rien qu’il ne s’est rien passé… » J’en ai bien ri. Depuis, je surveille mon cœur et tempère mes émotions.
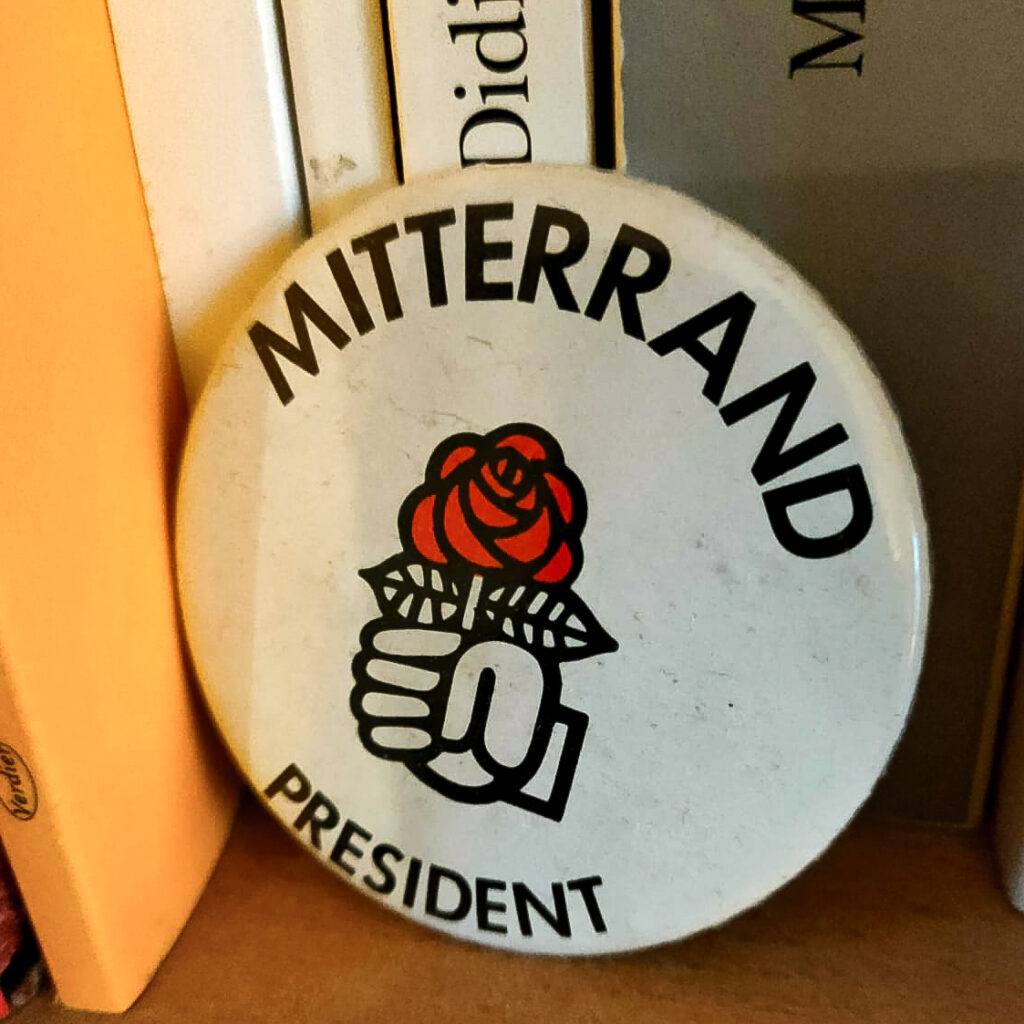
Badge de la campagne de 1981
10 mai 1981. La victoire. J’ai 17 ans, et j’enrage littéralement de n’avoir pas pu voter. La frustration est rapidement emportée dans la liesse. Il flotte dans l’air une énergie neuve, un enthousiasme ravivé à chaque nouvelle décision historique. Lydie et Elisabeth le répètent à longueur d’interviews: ce 10 mai fut le plus beau jour de leur vie. Elisabeth est à Paris, aux premières loges. De la rue de Solférino à la rue de Bièvre où son beau-père l’accueille d’un « qu’est-ce qui nous arrive? »3, un tourbillon l’emporte. Jamais plus depuis, une élection présidentielle ne fit souffler à une si grande échelle un tel vent de légèreté sur le peuple. Pendant ce temps-là la haute bourgeoisie et la finance se mettent à trembler tandis que la bourse vacille. La presse titre sur « la panique des notables » qui planquent leurs avoirs en Suisse et, sans rire, s’endorment le soir en imaginant, dans le sinistre sillage des nationalisations à venir, des chars russes stationnant sur la place de la Concorde 4. Raviver cette mémoire-là, c’est réaliser combien le Parti socialiste qui voit aujourd’hui de l’extrême-gauche partout, serait dans la totale incapacité de susciter chez le bourgeois ne serait-ce que le quart de la moitié d’une peur irrationnelle de cette nature. Trois ans plus tard, alors que commençaient à poindre les premiers signes de désenchantement qui suivent toujours les grandes flambées de passion, ma petite amie anglaise qui faisait ses études en France avait encore un poster de Mitterrand dans sa chambre, une sorte d’antidote, pour elle, à la cauchemardesque Margaret Thatcher dont la politique brutalement ultra-libérale mettait les classes populaires britanniques à genoux. La Tontonmania, à peine entamée par le tournant de la rigueur, a duré longtemps.
Dans le lointain ouest gersois (le far west, donc) où elle a fait son nid, Elisabeth Mitterrand s’intéresse plus que jamais à la chose publique. En 1998, elle est élue conseillère régionale. En 2001, elle devient maire de Sion, son village qui compte moins de cent habitants. Plus tard, elle présidera la communauté de communes du Bas-Armagnac. On ne reste pas plus de vingt ans maire d’un si petit village sans être profondément, et de manière désintéressée, concerné par la vie et le sort de ses contemporains. Elisabeth Mitterrand aimait les gens avec sincérité et ne rechignait jamais à s’occuper des trivialités du quotidien. Ce genre d’engagement ne trompe pas. Une sincérité confirmée par son premier adjoint, Michel Bragagnolo, qui a eu des mots simples et émouvants lors de la cérémonie organisée à Sion pour ses obsèques. Elle eut des engagements multiples, fut une indéfectible fidèle de Martin Malvy au conseil régional de Midi-Pyrénées dont elle fut élue, pendant toute la durée de sa présidence, de 1998 à 2015. Elle s’y est notamment beaucoup occupé des lycées. Sa capacité de travail en même temps que son leadership comme on dit dans les écoles de management, l’ont porté pendant plusieurs années à la présidence du conseil d’administration de Sciences po Toulouse. De nouveau candidate en 2015, son positionnement en sixième position sur la liste présentée par le Gers ne lui a pas permis d’être élue.
Son parcours aurait pu, aurait dû la conduire sur les bancs de l’Assemblée nationale. Elle en eut l’ambition en 2002, sur la première circonscription du Gers que le Parti socialiste avait — cela tombait bien — réservé à une femme. Elle fut candidate à l’investiture, avec le maire d’Auch, Claude Bétaille comme suppléant. Se présentait également une certaine Marie-Pierre Desbons, à l’époque adhérente du Parti socialiste, et qui voyait sans doute là une bonne opportunité de se lancer en politique. Dans le contexte de l’après 21 avril, puis de l’élection de Jacques Chirac avec un score écrasant face à Jean-Marie Le Pen, cela créa un trouble, généra quelques convulsions aussi obscures que souterraines qui prirent pour certains l’apparence d’opportunités à saisir et finirent par convaincre François Hollande, alors Premier secrétaire du Parti socialiste, de désavouer la décision de son conseil national en annulant d’un autoritaire et inexplicable trait de plume la réservation de cette circonscription à une candidature féminine. A la veille du vote des militants, Elisabeth Dupuy-Mitterrand et Marie-Pierre Desbons firent une conférence de presse pour dire leur indignation et annoncer le retrait de leurs candidatures. Ceci fut semble-t-il accompli au nom de « particularismes locaux » dont on aimerait bien, pour le plaisir ou le fun aujourd’hui, connaître et le détail et la nature exacte… Interrogé au lendemain de son décès à la sortie d’une librairie de Condom où il venait dédicacer un livre, François Hollande, l’artiste des formules auto-dérisionnelles à sens multiples, eut en rendant un hommage convenu à sa mémoire, cette phrase qui, pour le coup, se pare d’un relief particulier: « C’est une coïncidence tout à fait douloureuse qu’elle disparaisse alors que je suis dans le Gers. » On n’aurait su mieux dire.
A cette époque récente, dans le Gers et sans doute ailleurs aussi, on disposait encore ainsi des femmes en politique: avec brutalité et mépris
En 2002, Philippe Martin fut donc élu député. La chose n’a sans doute aucun rapport (quoi qu’en cherchant bien…) mais deux ans plus tard, la candidate que la droite avait envoyé perdre —et qui perdit comme de juste — face à lui, eut la vélléité d’être de nouveau candidate de son parti, mais cette fois-ci à l’élection régionale. La lettre que Geneviève Broussy avait adressée dans ce sens à Yves Rispat, patron plénipotentiaire de l’UMP et de la droite locale, ne reçut jamais la moindre réponse. Un jour elle apprit, comme tout le monde dans le journal, que son nom ne figurait pas sur la liste. De rage, d’humiliation et de dépit, elle en démissionna publiquement du conseil municipal d’Auch où elle siégeait sur les bancs de l’opposition. Le rapprochement de ces deux faits permet juste de noter qu’à cette époque récente, dans le Gers et sans doute ailleurs aussi, on disposait encore ainsi des femmes en politique: avec brutalité et mépris. En 2007, Elisabeth fut de nouveau candidate à l’investiture pour les élections législatives, sur la deuxième circonscription du Gers. Une nouvelle fois son nom ne fut pas retenu. D’aucuns garderont l’impression que son franc-parler et sa tête dure n’y étaient pas pour rien. Si tel est le cas, ces deux camouflets sont deux médailles décernées à son inflexibilité et à sa droiture.
Ces deux échecs dont elle aurait légitimement pu prendre ombrage ne l’ont jamais détournée des âpres servitudes de la politique locale. On se souviendra qu’elle fut l’artisan efficace du Schéma de cohérence territorial du Gers, le Scot, une instance et un document largement méconnus du grand public dont l’objectif est de mettre d’accord les élus d’un territoire donné sur des orientations collectives d’aménagement à moyen et long terme. Dans le Gers, le Scot englobe la quasi-totalité des communes du département. Il faut pour ce genre de mission cumuler un certain nombre de qualités: une fine connaissance du terrain, de l’autorité et un grand sens de la diplomatie. Sa poigne en même temps que son art du dialogue ont fait merveille.
Pour qui savait y voir, le regard d’Elisabeth qui se perdait souvent au loin, portait perpétuellement en lui un voile discret, comme l’ombre d’une tristesse, ou l’expression d’une forme de détachement. Je l’ai maintes fois remarqué lorsque je l’ai croisée plus tard, en de multiples occasions, et sans que nous n’ayons plus l’occasion de nous parler aussi ouvertement que lors de ce fameux déjeuner: le visage d’Elisabeth, sa silhouette faussement frêle, sa voix métallique et rocailleuse de fumeuse au long cours, son air souvent tendu, tout cela lui donnait parfois l’allure d’un vieux boxeur entraîné à encaisser les coups, dur au mal mais sensible aussi, capable d’en prendre une et de vous décocher par bravade un éclat de rire en retour, du genre qui ravale ses larmes, serre les dents, et relève le menton. Bref, elle me faisait l’effet d’une dure à cuire qui ne mâchait pas ses mots et que l’on devinait potentiellement casse-pieds à ses heures. Une dure à cuire qui en avait sans doute bavé comme en bavent, généralement, les fortes têtes. Et l’on ne pouvait s’empêcher de penser qu’il n’avait pas dû être tous les jours facile de vivre sans se brûler dans l’un des tout premiers cercles orbitaux du Président Soleil 5.
Lorsque je l’ai rencontrée, son ex-mari Jean-Christophe Mitterrand finissait de se débattre dans d’interminables déboires judiciaires qui quelques mois plus tôt faisaient encore l’objet de longs articles dans la presse nationale. Elle était séparée de lui depuis longtemps mais les autorités en charge des enquêtes et instructions en cours lui avaient interdit de divorcer, ce qu’elle put finalement faire en 2004, totalement exonérée de tout potentiel soupçon de complicité.
Pour toutes et tous, dans sa famille et dans le Gers, elle était « Minouche ». Je me suis personnellement toujours méfié des diminutifs dont il faut savoir user avec tact et discernement, surtout lorsqu’on ne fait pas partie du premier cercle des intimes, surtout lorsqu’on est en dehors d’un cadre privé ou amical. Car alors, ils ne sont plus des « petits noms » témoignant d’une affection et d’une proximité sincères, mais deviennent des instruments sournois concourant à diminuer non plus seulement le nom ou le prénom, mais la personne elle-même. Je n’ai jamais appelé Elisabeth Dupuy-Mitterrand Minouche, et ne l’aurais jamais fait sans qu’elle m’y ait explicitement invité. Je me suis en revanche toujours amusé à débusquer les « minoucheurs » de circonstance qu’elle savait fort bien, je n’en doute pas une seconde, repérer elle-même. Son surnom, j’en suis presque sûr, lui servait de détecteur à fourbes et à faiseurs. Elisabeth avait tout d’une femme subtile. Elle était droite comme un « I ». Et lorsqu’elle promenait son regard de chat sur ces assemblées d’hommes écraseurs, marioles, hâbleurs et roublards, qui ne se sont jamais trop gênés pour lui marcher sur les pieds, ils redevenaient soudain tout petits… et n’en avaient aucune idée.
Ce portrait d’Elisabeth Dupuy-Mitterrand n’a pas l’ambition d’être objectif, ni même conforme à ce qu’elle fut réellement pour celles et ceux qui l’ont connue ailleurs, autrement, mieux. C’est juste le souvenir, l’image que je garde d’elle, que j’emporte, et vous offre en partage.
________________________
1- Pendant son mandat, elle a notamment présidé l’intergroupe des députés membres de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH). Elle a également été vice-présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme.
2- Il fut dit, mais le saura-t-on jamais, que la nomination d’André Cellard au secrétariat d’Etat à l’agriculture, n’avait d’autre but que de permettre à Lydie Dupuy de devenir députée. Les élections suivantes de 1986 donnèrent lieu à de sombres batailles internes. André Cellard qui comptait bien reprendre son siège que Lydie Dupuy avait bien l’intention de conserver elle aussi, ne fut pas investi par le Parti socialiste et présenta sa propre liste sous les couleurs du MRG. Il obtint 2,45% des voix. Le PS gersois désigna Yvon Montané. L’élection fut remportée par l’UDF Aymeri de Montesquiou.
3- Journal Sud Ouest, 10 mai 2011
4- Cet article de Slate nous rappelle que cette image des chars russes à Paris avait une première fois été lancée par Michel Poniatowski lors de la campagne présidentielle de 1974, et qu’il la relança de nouveau en 1981.
5- Le président Félix Faure avait été en son temps surnommé le Président Soleil, ironiquement, pour moquer sa ridicule obsession de l’étiquette. Pour Mitterrand, le sobriquet ici recyclé n’a aucune dimension ironique et fait plutôt référence à l’aura du personnage, à son rayonnement et son sens de la pompe, qui furent traduits dans les surnoms de « Dieu » ou du « Sphinx » dont il fut réellement affublé de son temps, avec ironie cette fois.


Merci beaucoup pour ce très beau texte en hommage à Elisabeth. Je ne l’ai jamais appelée Minouche, j’avais trop de respect pour elle. J’ai travaillé pendant 7 ans avec elle au Cabinet de Martin Malvy. C’était une femme vraie, avec des valeurs de gauche. Une humaniste avant tout. Les dernières fois que je l’ai croisée, c’était au Festival de Marciac Aux inaugurations qu’elle ne ratait jamais, à l’invitation de son voisin Jean Louis Guillaumon, un ami, parce que l’amitié voulait dire quelque chose pour cette femme, qui a pourtant était tellement trahie par « ses amis de gauche ». Si elle représente une chose pour moi, c’est la persévérance qu’il faut avoir, face au monde des hommes Politiques. Jamais ne n’oublierai ce chemin qui peut servir d’exemple aux femmes en politique. Merci encore!