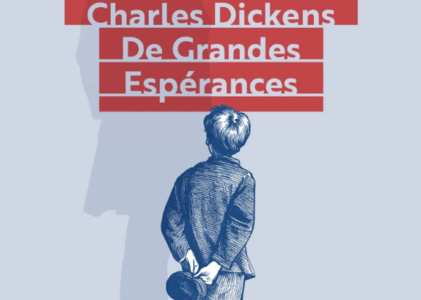[Mardi 30 août 2022] Bonne nouvelle pour tous les amateurs de (très) bonne littérature populaire : les éditions Tristram ont publié cette semaine (le 25 août) une nouvelle traduction des Grandes Espérances de Charles Dickens. On la doit à Jean-Jacques Greif qui s’était précédemment illustré chez le même éditeur en proposant une traduction décoiffante de L’Île au trésor, de Stevenson. Un exercice de haute volée qui donnait enfin accès à tous les lecteurs francophones à l’extraordinaire liberté langagière du texte original que les précédentes traductions avaient passablement rabotée. Avec De Grandes Espérances, roman majeur dans l’œuvre foisonnante de Dickens, Jean-Jacques Greif renouvelle avec bonheur l’exercice. Ce dépoussiérage nous permet d’approcher, dans notre langue française du XXIe siècle, au plus près de cette langue anglaise du XIXe siècle fouettée avec vigueur et joie de vivre par un Charles Dickens au sommet de son art. Les amateurs éclairés de littérature anglaise ne manqueront pas de repérer ici ou là des tournures empruntées par Dickens à la geste sternienne, hommages discrets 1 à son aîné Laurence Sterne, auteur du monumental et impérissable Vie et opinions de Tristram Shandy, oeuvre centrale du catalogue des éditions éponymes Tristram à qui il aura fallu une bonne décennie de labeur pour superviser la moderne et flamboyante traduction qu’en a donné Guy Jouvet en 1998. Alors que pas plus tard que ce lundi, l’essayiste et romancière Cécile Guilbert se demandait sur France Culture si cette traduction de Guy Jouvet n’avait pas un peu trop « boosté » le texte original (écouter ici, à la 54e minute), il a à n’en pas douter ouvert une voie dans laquelle les éditeurs de Tristram n’ont pas manqué de s’engouffrer avec jubilation (n’oublions pas de citer les admirables traductions, dans ce même esprit et chez le même éditeur, des Aventures de Tom Sawyer et des Aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain, par feu Bernard Hoepffner).
Mais, foin de ces considérations, voilà donc qu’en cette fin d’été, en un temps de presque rentrée, un bon gros livre de 600 pages nous invite à prolonger nos vacances par une lecture qui, de page en page, devient rapidement compulsive. Si cette rythmique nous est immédiatement familière, c’est qu’elle est celle des séries télé dont nous vivons en ce moment-même une apogée du genre. De Grandes Espérances a été publié en feuilletons, de décembre 1860 à août 1861, en 36 épisodes hebdomadaires. Cette contrainte formelle contribue à donner à l’ensemble sa densité et son rythme en constante accélération. Afin de ne pas prendre le risque de dévoiler le moindre des innombrables rebondissements dans le roman, on dira peu de choses ici de l’histoire racontée, celle de Philip Pirrip, alias Pip, jeune orphelin issu d’une famille déclassée et promis par un coup du sort parfaitement improbable à un brillant avenir. Roman d’initiation, De Grandes Espérances amène son lecteur à suivre les évolutions du jeune héros, tour à tour confronté aux dures cruautés de l’existence, aux affres et délices des amours impossibles, aux expériences des sentiments d’injustice, de culpabilité, de gratitude ou de dépit, aux espérances folles et aux déceptions amères.
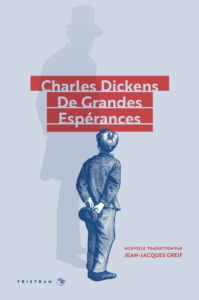
En librairie depuis le 25 août dernier, De Grandes Espérances, de Charles Dickens, édition Tristram. Traduction Jean-Jacques Greif. Couverture réalisée par le graphiste Thierry Dubreil.
On ne se lasse pas de l’extraordinaire galerie de personnages mis en scène, et l’on est frappé par le traitement que réserve Dickens aux classes les plus pauvres de la société anglaise, un monde extrêmement marqué par sa culture de classes, où les regards et la considération n’en finissent pas de s’abaisser de l’aristocratie à la bourgeoisie, de la bourgeoisie à la classe moyenne, de la classe moyenne aux prolétaires, et des prolétaires jusqu’aux bas-fonds de l’humanité représentés, entre autres, par les criminels et les bagnards. Au fil des pages et des rebondissements, on est saisi par la puissance des descriptions, par la capacité de l’auteur à faire naître des images tout en nous faisant entrer au coeur même de la psyché de chacun des personnages. L’ensemble baigne dans des bons sentiments qui jamais ne basculent dans le mièvre, mais dessinent peu à peu les contours d’une morale qui structure tout le récit.
S’affirment ainsi en creux quelques évidences telles que la valeur des hommes ne dépend pas du volume de leurs possessions, ou que la capacité de faire le bien comme le mal est en chacun de nous. On découvre les sentiments humains les plus élevés chez les personnages les plus frustres et les moins éduqués. Même si les personnages de « bons riches » et de « méchants pauvres » nous préservent de tout manichéisme caricatural, il y a néanmoins chez lui, de toute évidence, une empathie particulière à l’égard de ceux qui triment et qui souffrent, au point que la question de savoir si Dickens ne serait pas un écrivain plutôt « de gauche » mérite sans doute d’être posée, de même qu’il n’est pas interdit de se demander si cette connaissance manifestement très fine des classes populaires ne dissimulerait pas un militantisme de la cause prolétaire… Cette intuition peut être sournoisement renforcée par le fait de savoir que Dickens lui-même, enfant âgé d’une dizaine d’années à peine, fut astreint à un terrible travail d’usine, ses parents, condamnés pour dettes, ayant été emprisonnés.
Ces questions pourraient sembler hors de propos, et elles le sont sans aucun doute s’il ne s’agit que de parler littérature. Elles furent pourtant régulièrement posées en Angleterre où la tentation d’enrôler Dickens dans des combats de gauche s’est régulièrement manifestée. Il y a dix ans encore, en 2012, Socialism Today, le magazine du Parti socialiste britannique n’hésitait pas à faire de Dickens son « champion des pauvres« , alors même que dès 1939, dans un formidable essai qu’il consacrait au père d’Oliver Twist, de David Copperfield et autres Pip, George Orwell, socialiste on ne peut plus patenté, semblait avoir définitivement réglé le débat. Pour être totalement convaincu que cette question du soi disant socialisme de Dickens est effectivement réglée pour l’éternité, il faut absolument lire cette très fine analyse de son oeuvre figurant dans un recueil de textes et essais d’Orwell publiés en 2005 par les éditions Ivrea.
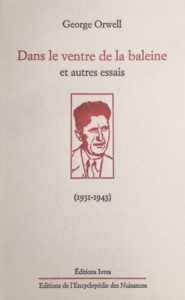
Dès la première ligne, Orwell prévient: « Dickens est de ces écrivains sur lesquels tout le monde veut faire main basse. » En 74 pages réparties en six chapitres, il règle magistralement son compte à toute mythologie qui chercherait à faire passer Dickens pour un pur champion de la cause prolétaire. Orwell qui voit dans De Grandes Espérances, « une véritable critique de la mentalité paternaliste » explique dès les premières pages et démontre au long de l’essai, exemples à l’appui pris dans l’ensemble son oeuvre, que « tout le message de Dickens tient dans une constatation d’une colossale banalité: si les gens se comportaient comme il faut, le monde serait ce qu’il doit être ». « Le fait est, détaille Orwell, que la critique de la société développée par Dickens est presque exclusivement une critique morale. D’où l’absence dans son oeuvre de toute proposition constructive. Il s’en prend aux lois, au gouvernement parlementaire, au système éducatif, etc., sans même jamais évoquer ce qu’il mettrait à la place. […] Rien dans son oeuvre n’indique nettement qu’il souhaite le renversement de l’ordre existant, ni qu’il pense que bien des choses seraient changées si cet ordre était effectivement renversé. » Plus loin, à propos de la critique du système éducatif, Orwell explique: « La critique de Dickens n’est ni créatrice ni destructrice. Il voit bien la stupidité d’un système éducatif fondé sur le lexique grec et les coups de canne; cependant il n’est pas partisan non plus du nouveau type d’établissement que l’on voit surgir dans les années cinquante et soixante […]. Que veut alors réellement Dickens? Comme toujours, ce qu’il souhaite c’est une réforme morale de l’institution existante — l’école à l’ancienne manière, mais sans coups de canne, sans mauvais traitement ni privation de nourriture, et avec moins de grec. »
Le réformisme moral de Dickens est bien loin d’un quelconque révolutionnarisme socialiste. Mais alors, Dickens ne serait-il pas plutôt de droite? Cette manie à vouloir classer les écrivains « de droite ou de gauche » est une passion bien française 2. S’il est définitivement établi que Charles Dickens n’est pas socialiste, peut-on néanmoins le classer « à gauche » et le considérer ainsi comme faisant (un peu) partie des nôtres? Sa réelle compassion pour le sort des plus démunis et les victimes d’injustice plaide pour un coeur à gauche. Mais son incapacité à envisager la moindre transformation sociale pour remédier aux maux du siècle le remet sur le rail conservateur.
Si l’on cherche un point de vue de droite conservatrice chrétienne, on tombe rapidement sur cet article de la Foundation for Economic Education, organisation américaine tout à fait droitière qui n’hésite pas à faire de Dickens (abusivement, n’en doutez pas) son propre champion, avec quelques arguments toutefois raisonnables que l’on retrouve également chez Orwell. Le fait est que Dickens n’a jamais remis en cause les principes du capitalisme. Ainsi que le fait justement remarquer l’auteur, William E. Pike qui, comme tout bon pasteur américain de droite est un fervent adepte de la philanthropie individuelle, s’attaquer à la cupidité n’est pas remettre en cause le capitalisme. Ce que ne relève pas cet article et que souligne en revanche Orwell, c’est que Charles Dickens pour qui « la gentillesse individuelle est le remède à tous les maux » est un révolté sincère contre toute forme d’autorité. « Il est, partout et toujours, du côté des vaincus », note Orwell qui ne manque pas de relever que cette position le conduit logiquement à « changer de camp » lorsque le vaincu devient le vainqueur. « Il déteste l’Eglise catholique, mais dès que les catholiques sont persécutés (Barnaby Rudge), il se range de leur côté. Il déteste encore plus l’aristocratie, mais il suffit que les aristocrates soient réellement persécutés pour que ses sympathies leur soient acquises. » Cette attitude relève sans doute d’une forme de sincérité naïve. « S’il a été populaire de son temps, et s’il l’est encore, c’est principalement parce qu’il a su exprimer sous une forme comique, schématique et par là même mémorable, l’honnêteté innée de l’homme ordinaire », note Orwell qui se réfère ici au concept qui lui est cher de la « common decency ». Et de conclure son saisissant portrait d’un pur « libéral du XIXe siècle anglais » par une image qui résume tout l’attachement qu’il lui porte, celle du « visage d’un homme animé d’une colère généreuse, une intelligence libre, un type d’individu également exécré par toutes les petites orthodoxies malodorantes qui se disputent aujourd’hui le contrôle de nos esprits ». Un point de vue de 1939 qui n’a pas pris une ride!
Ce qui peut nous rendre Charles Dickens proche de nous, c’est son aptitude à l’indignation face à l’injustice et à la méchanceté du monde. C’est sans doute peu, mais c’est déjà ça. Mais s’il nous faut une vraie raison pour le lire (ou le relire dans cette nouvelle traduction), contentons-nous de son extraordinaire talent de raconteur d’histoires, de son art de la digression, de son goût immodéré du détail dérisoire ou superflu, de son aptitude à manier les invraisemblances, de sa géniale faculté à camper des personnages dont les traits s’impriment de manière indélébile dans la tête du lecteur. Pour ce qui est du roman qui nous occupe, De Grandes Espérances, Magwitch le bagnard, Joe le forgeron, l’étrange Miss Havisham et la troublante Estella, l’inflexible avocat Jaggers et Wemmick, son clerc drôlissime, le vaniteux Pumblechook, la famille Pocket, la cousine Biddy (et on en oublie), tous tourbillonnant autour de ce jeune Pip voué à devenir un gentleman taillé sur mesures, forment tout un monde dans lequel il faut se garder des faux-semblants et se méfier de ses propres emportements. Les grandes espérances ont souvent pour corollaires les grandes désillusions…
On peut aisément se contenter du divertissement de haute qualité que procure la lecture souvent haletante de ce roman. On peut aussi en tirer quelques matières à réflexion sur la société des hommes et la marche du monde, noter au passage un certain nombre d’invariants dans la liste des ambitions, des rêves et des désirs qui, d’un siècle à l’autre et avec une remarquable constance, nous traversent, et se dire que si Dickens n’a jamais songé à changer le monde pour changer le coeur des hommes, il est toujours temps d’y penser à sa place…
_________________________________________
1- Ceci est une pure conjecture personnelle…
2- Lire à ce propos l’excellent article de la sociologue Gisèle Sapiro paru en 2001 dans la revue Sociétés & Représentations (lire ici).